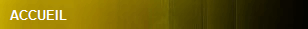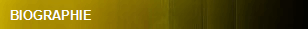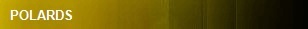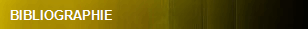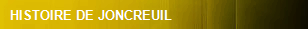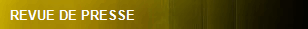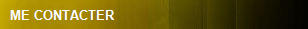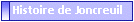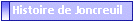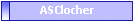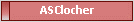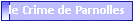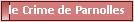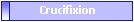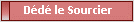Histoire de Joncreuil

Au Village :
Il fut certainement bâti par les moines de la Chapelle aux Planches qui vinrent vers l’an 900 défricher la
foret de Parnolles où ils construisirent une ferme monastère appelée du nom latin Sancta-Pétronilla qui
deviendra ensuite Sainte Pétronilles en la foret, puis Pernolles et enfin Parnolles que nous connaissons
aujourd’hui. Les forêts de Lentilles, Drosnay et celles de Margerie, sont les restes d’un vaste massif boisé qui
couvrait la presque totalité du territoire de Joncreuil à cette époque, avant que les moines viennent
défricher.
En 1156, Joncreuil appartient aux comtes de Rosnay. Ensuite aux comtes de Champagne qui leur ont
succédés. En 1156, Henri comte de Troyes déclare que le village dépend du comté de Rosnay et abandonne
son droit de terrage sur Parnolles. Ses vassaux l’imitent, Pierre de pougy l’année suivante et Simon de
Beaufort en 1184.
En 1157 ( sous le règne de Louis VII ) Pierre de Pougy dont une fille était devenue nonne à la chapelle
aux Planches (où il y avait alors couvent d'hommes et couvent de femmes) fit don à cette abbaye de ses cens
et terrages de Parnolles et d'Outines et d'une rente en grain sur le terrage de Joncreuil.
En 1185 ( sous le règne de Philippe Auguste ) début de la construction de la partie romane de l'église.
Entre 1204 et 1206 ( sous le règne de Philippe Auguste ) Renaud II de Pougy qui était vassale du comte
de Rosnay pour la justice de saint Léger sous Margerie et le fief de Joncreuil, avait la mouvance sur le dit
Joncreuil. Ce Renaud était de la branche aînée de la maison de Pougy tandis que Pierre était d'une branche
cadette.
En 1230, apparaît Guillaume de Chapelaine qui assied le douaire de sa femme Helwide de Tourotte sur
Chapelaine et la moitié de Joncreuil, son gendre Raoul Britaud vend cette moitié en 1230 à Pierre Goin,
d’où elle passe à Lambert de Bar.
En 1238, les revenus seigneuriaux sont en de multiples mains. Le comte de Champagne perçoit des droits
de terrage et un droit appelé «soignées» la dame de Tanière quelques setiers de grain et une geline
(poularde). Britaud de Joncreuil possède en fief, la moitié du village avec la justice des près, terres, bois et
autres choses. Apparaît alors le seigneur du Chatelier qui, au XVIè siècle, devient le seigneur principal.
En 1263, ( sous le règne de Saint Louis ) Guillaume fils de Lambert de Bar sur Aube, avait à Joncreuil
des hommes et un étang le tout valant un revenu de 60 coudées de terre, relevant de Rosnay.
En 1266, Le premier octobre, Jean de Tourotte, chevalier, seigneur du Chatelier, possède le village de
Joncreuil à l’exception d’une rue. Il y perçoit la taille sur ses hommes et femmes, taillable haut et bas., des
terrages sur lesquels l’abbé de la Chapelle aux Planches, prend un quart. Un gagnage pouvant valoir par an,
15 grands setiers par moitié froment et avoine, 9 arpents de bois, moitié de l’étang et le droit de justice sur le
tout.
En 1274 ( sous le règne de Philippe le Hardi ) la moitié de la justice et d'autres revenus de Joncreuil
appartenaient à Raoul Britaud de Joncreuil. A cette même date la dame de Tasnières avait à Joncreuil, en
fief, une rente de quatre setiers et d'une geline (poularde).
Vers 1275 ( sous le règne de Philippe III le Hardi ) Joncreuil dépendait du fief de Rosnay et il appartenait
au seigneur du Chatelier. Il est situé aux limites des trois départements Aube, Haute Marne et Marne. Il doit
son nom au règne végétal ( les joncs ) qui recouvraient une grande partie de son territoire.
Au mois de février 1313, ( sous le règne de Philippe VI le Bel ) Simonin le Pipat de Chalette écuyer
reconnut que les moines de la chapelle aux Planches avaient le droit de prendre chaque année un grand
setier de froment sur le terrage de Joncreuil et sur le terrage de Sainte Marie (Margerie) au même finage et
en sa justice, au mois de mai suivant. Aubert de Tourotte, chevalier, sire du Chatelier (commune de
Chavanges) à la demande du dit Simonin, confirma cette reconnaissance. Cet Aubert de Tourotte était peut
être le co-seigneur de Simonin, en tout cas, sa famille apparaît un peut plus tard parmi les seigneurs de
Joncreuil en la personne de Jeanne de Saint Cheron veuve de Jean VII de Tourotte sire du Chatelier et
d’autres lieux, qui est qualifiée en 1372, dame de Chavanges, Chassericourt, Brandonvilliers, Outines,
Joncreuil et la Braux. (Longnon document II-568)
En 1370 et 1404 ( sous le règne de Charles V ) Joncreuil possédait un four banal qui, appartenait au
seigneur de Beaufort.
Dès 1495 et encore en 1504, ( sous le règne de Louis XII ) cinq dixièmes de la terre du Chatelier et de ses
dépendances, Chavanges, Joncreuil, Outines appartenaient à Guillaume II de Hangeot, comte de Dampierre
en Astenois et Baron d'Arzilliers. Le dernier dixième des dites terres appartenait en 1504 à Jeanne de
Toulonjon, Jeanne de René 1er de Clermont d'Ambroise et ce sixième relevait de Beaufort (aujourd'hui
Montmorency Beaufort).
En 1503, René de Clermont, chevalier, vice amiral de France, seigneur du Chatelier en partie grâce à
Jeanne de Thoulonjon, sa femme possède la justice et la mairie de Joncreuil, la taille, le gagnage de
Leurigny, la moitié de l’étang de Joncreuil, le bois du Plessis contenant environ 9 arpents et le cens de la
garde de l’étang de Parnolle appartenant au Prieuré de Margerie. Ces possessions étaient partagées pour les
revenus avec un co-seigneur, sauf le gagnage de Leurigny.
En 1556 ( sous le règne de Henri II ) c'est Claude de Toulonjon qui avait toutes ces terres. Au XVIè
siècle, on retrouve les sires du Chatelier en même temps, seigneurs de Joncreuil.
En 1604, ( sous le règne de Henri IV ) c'est encore un Toulonjon le comte de Grandmont. Puis en 1636.
François de L'Hospital, comte de Rosnay, seigneur du Hailler et maréchal de France qui les possédait. Après
sa mort, toutes ces terres furent vendues aux enchères, les 10 juin et 1er juillet 1673, à Marie Ignace de
Lorraine princesse d'Elbeuf, qui eut pour successeur François de Lorraine prince de Commercy et ensuite
Charles de Lorraine également prince de Commercy. Après celui-ci elles furent de nouveau vendues à divers
acquéreurs. Pour Bailly le Franc et Joncreuil ce fut Gilles 1er Jaquinot qui les possédait en 1700. Les sieurs
et la demoiselle Jacquinot, ainsi que ses enfants en 1732. Gilles II Jacquinot, l'un des dits enfants, en 1756.
En 1769 les enfants de Gilles II, notamment Gilles Joseph avocat au parlement. En 1761, Maître Jacquinot
officier près le Roi.
En 1625, François de l’Hopital, seigneur du Chatelier et de ses dépendances pour le tout achète la
seigneurie de Tanière et devient ainsi propriétaire de la totalité de l’étang de Joncreuil et du fief de
Dienville qui pourrait bien être le petit fief dépendant de Tanière, mentionné en 1275.
En 1700, le 1er juin, Gilles Jacquinot achète Joncreuil, Bally le Franc et Labraux au prince de
Commercy. Il eut plusieurs enfants, dont Gilles II Jacquinot né à Chavanges le 8 août 1704 décédé le 24
septembre 1756 reçu Joncreuil en héritage de la succession de son père le 16 février 1729. Gilles II eut
quatre enfants, Barbe Catherine née à Chavanges 1er octobre 1731 qui épousa Paul Tugnot. Marie Catherine
née à Chavanges 14 novembre 1936, qui épousa Pierre Gilles Bonnescuelle de Surmont le 13 août 1764.
Geneviève née à Chavanges 21 février 1738 qui épousa Jean Baptiste Joseph Duc de Montigny le 5 janvier
1767. Gilles Joseph Martin né à Chavanges le 27 septembre 1739, il fut bailli de Chavanges et devint
président du tribunal du district d'Arcis en 1790. Gilles Bonnescuelle était maire de Joncreuil en 1793 lors
du crime de Parnolles.
BIENS COMMUNAUX

L' histoire du village de Joncreuil




Menu

Site : http://claude.felix.livres.free.fr
2016 | Claude FELIX Livres | Tel : 03.25.92.99.60 | Email : lemajor.tonton@orange.fr |
2016 | Claude FELIX Livres | Tel : 03.25.92.99.60 | Email : lemajor.tonton@orange.fr |
Les déclarations des usages communaux ont été faites en 1609 et 1640. Voici le résumé de la dernière qui
est la plus importante. 1° 4 fauchées au lieu dit les grands Paquis. 2° 4 fauchées lieu dit le Barreau de la
Landière. 3° une fauchée lieu dit le Petit Bartel tenant à l’étang de Bailly. 4 fauchées lieu dit le Grand
Paquis de la Horre, tenant d’une part aux prés de la franchecourt d’autre part au gagnage de Beaufort, d’un
bout à la maison de la Horre, d’autre bout aux chemins royaux et voyeulx du dit Joncquereul par laquelle
Horre, deux grands chemins et voyeulx communs tenant d'une part aux prés de Parnolle, d'autre part et d'un
bout sur les prés de Beaufort. 6° un arpent lieu dit le Marchast. 7° 4 denrées lieu dit le pré aux Febvres tenant
d'une part à l'étang de Bailly d'autre part et d'un bout au gagnage de Morcey.
En 1636 ( sous le règne de Louis XIII ) c'est François de l'Hospital, comte de Rosnay, seigneur du Hallier
et maréchal de France qui les possédait, le fief relevait de Rosnay sauf quelques maisons du village qui
relevaient de montmorency, 4 ou 5 maisons tout au plus. Après sa mort, toutes ces terres furent vendues aux
enchères les 10 juin et 1er juillet 1673 à Marie Ignace de Lorraine princesse d'Elbeuf qui eut pour successeur
1er François de Lorraine prince de Commercy, 2ème Charles de Lorraine aussi prince de Commercy. Après
celui-ci elles furent de nouveau vendues à divers acquéreurs. C'est Gilles 1er Jacquinot qui les possède en
1700. Les siens et la demoiselle Jacquinot, ses enfants en 1732. Gilles II Jacquinot, l'un de ses dits enfants en
1756 et 1769 les enfants de Gilles II, notamment Gilles Joseph avocat au parlement en 1761 Maître
Jacquinot officier chez le roi.
En 1700, L’étang de Joncreuil a été racheté avec le bois du Plessis au domaine de Tanière au XVIIIè
siècle. Tanière a été acheté en 1700 par le frère de Gille Jacquinot avec Chavanges.
En 1702 ( sous le règne de Louis XIV ) on trouve dans les archives 2 morts en mars, 2 en avril, 4 en mai,
probablement une épidémie de choléra. Le 8 octobre 1854 une épidémie de choléra se déclare à Joncreuil,
une délibération mentionne l'achat de médicaments aux indigents pour un coût de 20F.
En 1786 ( sous le règne de Louis XVI ) une partie de Joncreuil appartenait à Bonnescuelle de Surmont.
D’après le recensement de 1787 il y avait 236 habitants à Joncreuil. D’abord étaient inscrits les notables.
Antoine Lombard, curé du lieu. Paul Tugnot ancien capitaine de cavalerie de l’ordre Royal et militaire de
Saint Louis seigneur de Joncreuil en partie demeurant au dit lieu. Pierre Louis Bonnescuelle de Surmont,
ancien officier d’infanterie, seigneur de Tanières Surmont et de Joncreuil en partie demeurant au dit lieu.
Après les notables venaient les autres habitants inscrits par ordre alphabétique.
LA REVOLUTION
en 1789 Ancienne circonscription civile, Joncreuil dépendait de l’intendance et de la généralité de
Chalons, élection de Vitry et du baillage de Chaumont.
Pendant la période intermittente, la commune a fait partie du canton de Montmorency du 20 janvier au 29
août 1790. Le village avait 236 habitants en 1787. D’après divers actes, le sieur Bonescuel de Surmont devait
remplir les fonctions de premier magistrat de la commune.
En 1790 on relève la naissance de Catherine fille de Gilles Joseph Bonnescuelle avocat au parlement. En
1792 Gilles Joseph, le même homme de loi, administrateur suppléant au directoire du département demeurant
au dit Joncreuil a l’effet de présente à l’officier public en conformité de la loi du 20 septembre 1792 relative
au mode de constat d’état civil des citoyens. D’après divers actes le sieur Bonnescuelle de Surmont devait
remplir les fonctions de premier magistrat de la commune.
En 1792 Gilles Joseph, avocat au parlement, homme de loi administrateur suppléant au directoire du
département demeurant au dit Joncreuil se présente à l’officier public en conformité de la loi du 20
septembre 1792, pour constater la relation au mode de l’état civil des citoyens.
Dans le canton de Chavanges en 1793, l’église ne compta pas un seul prêtre fidèle, tous se soumirent sans
réserve au décret de la constitution civile. Antoine de Lombard de Joncreuil, en faisait partie. Celui-ci,
agissant comme agent national, pesa lui-même les ornements et les vases sacrés,
chez l'épicier du village, puis il les envoya au district. Sa qualité d'agent l'obligea encore à concourir à
l'enlèvement de deux cloches et à la fermeture de l'église. Peu après il abdiqua.
Des actes de vandalisme eurent lieu un peu partout. La croix du cimetière de Joncreuil, un des plus beaux
spécimens de la sculpture de la renaissance, la figure du donateur qui y était représentée, a été brisée par les
révolutionnaires. Tout ce qui représentait l’ancien régime, notamment les fleurs de lys, disparut de l’église
par ordre de la municipalité, puis les statues et les croix furent à leur tour descendues. L’église servit de lieu
de réunion et de réjouissances, le presbytère fut loué à un particulier.
- Accueil
- Actualite
- Qui est Claude FELIX ?
- Biographie
- Polars
- Bibliographie
- Le Crime de Parnolles
- Le Coup de Folie de Ferdinand
- Histoire d'un Signe d'Insigne
- Les quatre poilus du monument
- Poivre Hier : Témoignages d’une nuit de cauchemars.
- Les 7 Mains Tendues
- Au Vieux Temps des Bistros
- C'est quoi ? Papy
- de la bute de tire au 106eme RI
- le charpentier de saint Pierre l es liens
- saint Pierre l es liens de joncreuil
- Histoire de Joncreuil
- Le Grele
- Revue de Presse
- Me Contacter